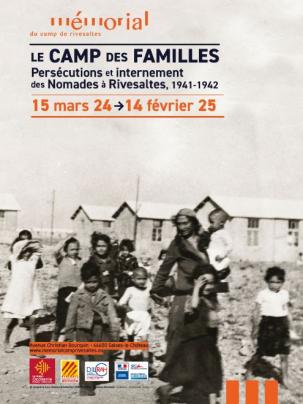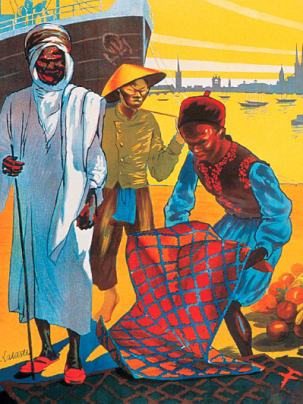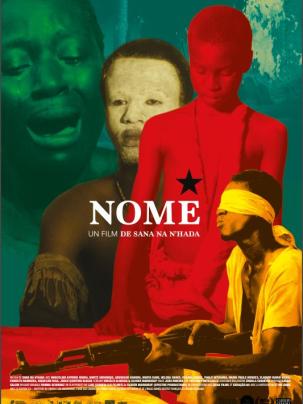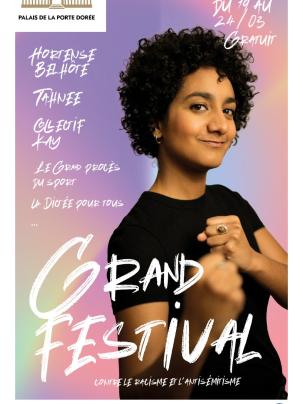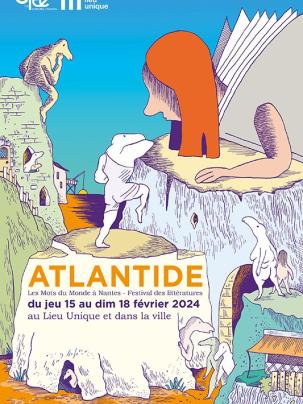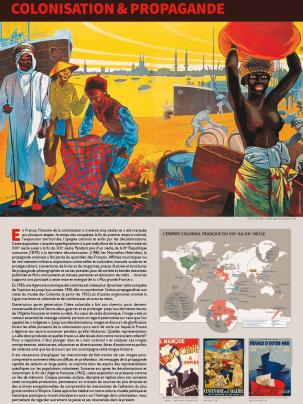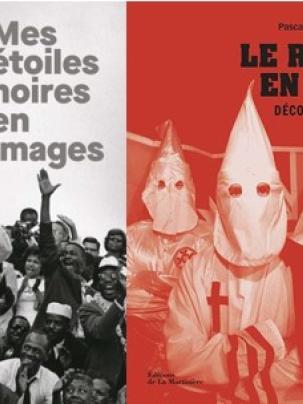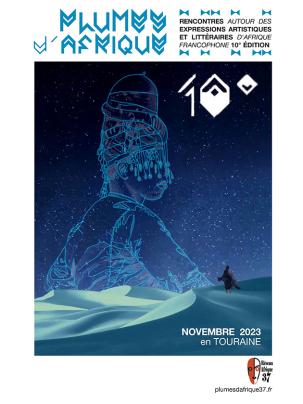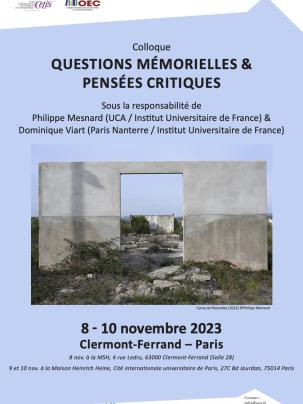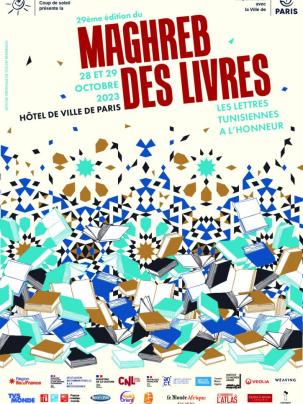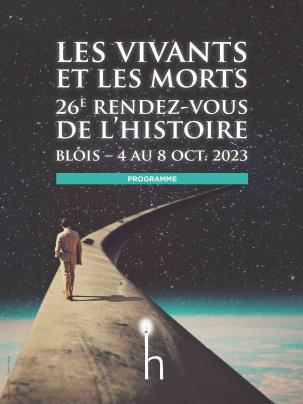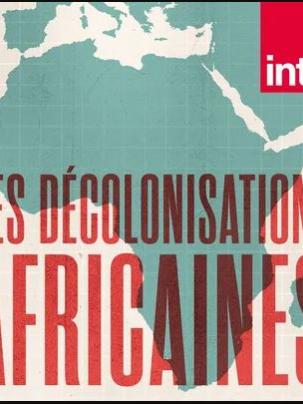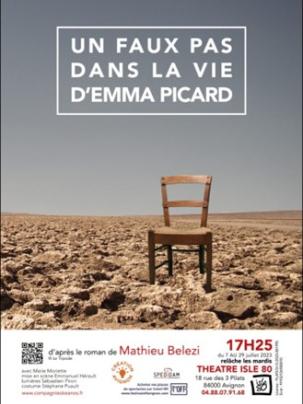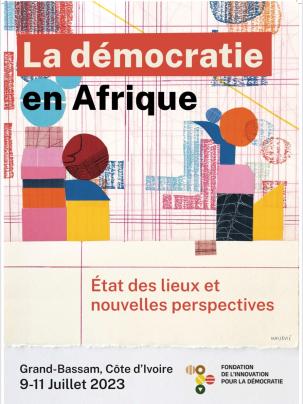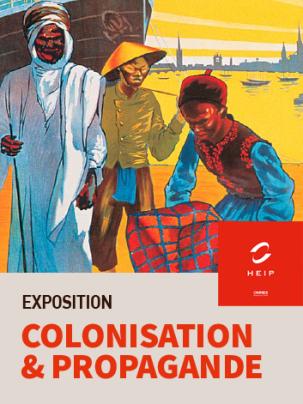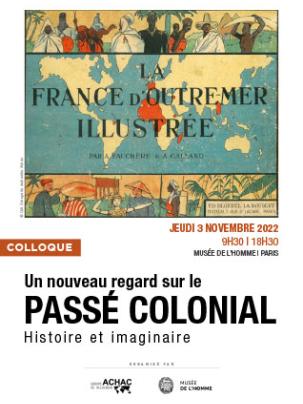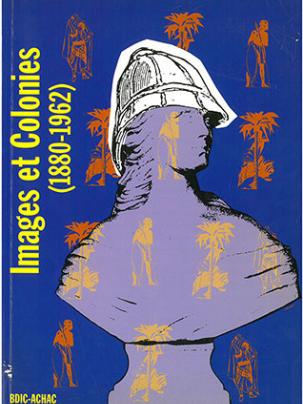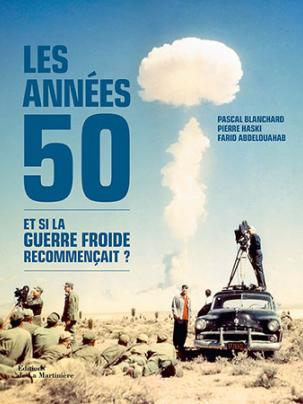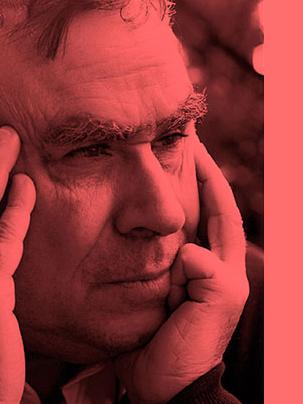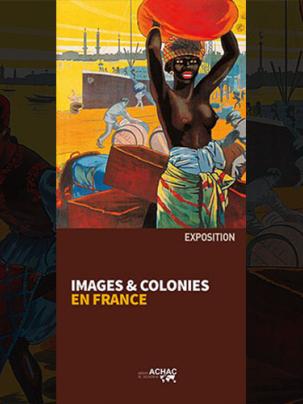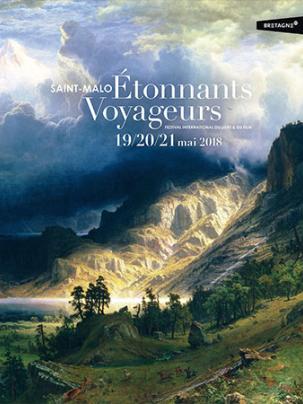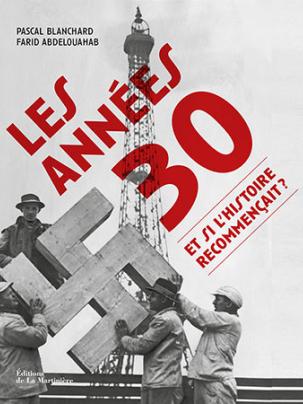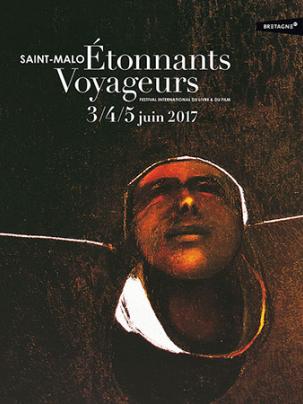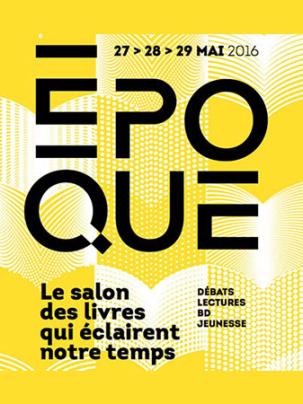Histoire & culture coloniale, evenements
Exposition
Rivesaltes , Mémorial du Camp de Rivesaltes
Exposition/Conférence
Rombas, Lycée Julie Daubie
Projection
Projection
Événement
Paris, Palais de la Porte Dorée
Conférence/Rencontre
Nantes, Le Lieu Unique – Grand Atelier
Conférence/Événement
Marrakech, Centre culturel Les Étoiles de Jamaa el FNA
Exposition/Conférence/Rencontre
Rencontre
Pointe-à-Pitre, Espace libraire, Carrefour de Destreland
Exposition
Nanterre, Lycée Joliot-Curie
Conférence
Tours, Auditorium de la Bibliothèque centrale
Colloque
Colloque
Clermont-Ferrand / Paris, Maison Heinrich Heine (Clermont…
Rencontre
Rencontre
Projection
Projection/Rencontre
Avignon, Théâtre Isle 80, 18 rue des 3 Pilats, 84000 Avignon
Colloque
Grand Bassam, Côte d'Ivoire
Exposition/Conférence
Paris La défense, École des Hautes Études Internationales…
Conférence
Sarcelles, Université populaire de Sarcelles
Colloque
Exposition
Blois, Rendez-vous de l'histoire de Blois
Conférence
Blois, Rendez-vous de l'histoire de Blois
Colloque
Exposition
Saint Malo, Festival Étonnants voyageurs
Conférence
Saint Malo, Festival Étonnants Voyageurs
Conférence
Saint Malo, Festival Étonnants Voyageurs