Du décolonial au wokisme. Des subaltern studies au décolonial en Afrique subsaharienne
(première partie)
par Catherine Coquery-Vidrovitch
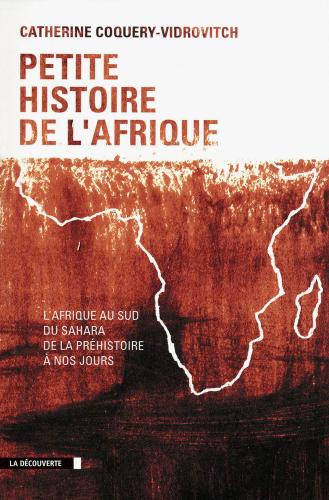
Catherine Coquery-Vidrovitch est une historienne spécialisée dans l’histoire africaine. Professeure émérite de l’Université Paris VII, ses travaux s’intéressent notamment aux enjeux politiques de la colonisation. Elle a publié de nombreux ouvrages, dont les plus récents sont Le choix de l’Afrique. Les combats d’une pionnière de l’histoire africaine (La Découverte, 2021) et Les routes de l’esclavage. Histoire des traites africaines VIe-XXe siècle (Albin Michel, 2021). Cet article entend analyser les réactions diversifiées des « Africanistes » face aux théories successives auxquelles ils se sont trouvés confrontés depuis plusieurs décennies : subaltern studies, post colonial studies, decolonial studies. L’attention est portée sur les réponses des chercheurs plutôt que sur le détail de ces théories dont, la plupart du temps, ils ne sont pas à l’origine. Cet article est proposé, en exclusivité, en deux parties dans la newsletter du Groupe de recherche Achac.
La genèse de l’histoire africaine de langue française
À la différence des sciences du présent, l’histoire de l’Afrique subsaharienne est une discipline récente, née en France avec les indépendances, c’est-à-dire le début des années 1960 ; elle n’a été reconnue comme telle que peu à peu. En 1960, nous autres historiens de l’Afrique étions en France une infime minorité au sein des études historiques. Les deux premières thèses d’État en histoire africaine furent soutenues par deux chercheurs sénégalais : Cheikh Anta Diop (sa première tentative remonte à 1954) et Abdoulaye Ly (1956).
L’Afrique au sud du Sahara était le champ privilégié des ethnologues et des anthropologues. Deux chaires d’Histoire furent créées en Sorbonne en 1962, tenues par d’anciens fonctionnaires coloniaux, à défaut d’historiens qui n’existaient pas encore : Robert Mauny (islam africain médiéval) et Hubert Deschamps (histoire contemporaine). En réaction contre l’histoire coloniale qui avait régné jusqu’aux indépendances – la seule chaire existante avait été celle de Charles André Julien (1947-1961), nous voulions écrire l’histoire du point de vue des colonisés, c’est-à-dire, comme on dit aujourd’hui, par le bas.
Ce fut la grande nouveauté des centres d’études géoculturels créés par Fernand Braudel à la 6e section de l’École pratique des hautes Études (EHESS autonome en 1976). Le Centre d’Études africaines était à l’époque pluridisciplinaire ; ses directeurs d’études étaient géographe (Gilles Sautter), anthropologue (Paul Mercier), sociologues (Georges Balandier et Denise Paulme, celle-ci spécialiste des femmes – on dit aujourd’hui du genre), linguistes (Pierre Alexandre pour les langues bantu et Pierre-Francis Lacroix pour le pular), historien enfin (Henri Brunschwig élu en 1961 auquel succéda Elikia Mbokolo). Jusqu’alors, la discipline historique es-qualité était rejetée tant l’histoire coloniale avait laissé de mauvais souvenirs. J’y entrai comme jeune assistante (chef de travaux) en 1962, Henri Moniot devenait de son côté maitre-assistant en Sorbonne. Les autres jeunes historiens étaient tous en partance pour des postes en coopération : Denise Bouche à Dakar, Claude-Hélène Perrot à Abidjan, Annie Duperray à Ouagadougou, Françoise Raison et Jean Frémigacci à Madagascar, Jean-Pierre Chrétien au Burundi, Jean-Louis Triaud à Abidjan puis Niamey. C’était le tout début de l’histoire africaine française. Nous avions à inventer, donc à prouver. Des années plus tard, Jean Copans, sociologue recruté au centre en 1969, me confia que le mot d’ordre entre eux y était de ne pas frayer avec les historiens tant la discipline avait hérité de sa mauvaise réputation d’histoire coloniale eurocentrée. Quelques années plus tard, j’eus la chance de pouvoir diriger les thèses d’État de deux jeunes historiennes qui se lançaient à leur tour, parmi les premières en France, en histoire africaine « vue d’Afrique » : Odile Goerg qui plus tard me succéda à l’Université Paris Diderot, et Monique Lakroum devenue professeure à l’université de Reims, toutes deux émérites aujourd’hui : le temps passe !
Le tournant des années 1960
Les années 1960 furent marquées par un renouveau de l’histoire économique dynamisée par la réflexion marxiste post et anti-stalinienne. Staline était mort depuis 1953 et le procès de ses idées sur l’empire était fait. Il s’agissait de repenser les facteurs explicatifs de l’exploitation et de la dépendance africaine sous domination coloniale. Les premières questions posées furent celles des profits et des coûts de la colonisation. L’idée force était de chiffrer l’exploitation des colonies par les colonisateurs, tout en répondant aux historiens classiques qui niaient la rentabilité de l’entreprise coloniale : ainsi Jean Stengers, éminent spécialiste du Congo belge, calculait « combien le Congo a coûté à la Belgique »[1].
Autre débat oublié aujourd’hui : la question des « modes de production », essentiels pour comprendre le fonctionnement des sociétés, le système de production étant toujours considéré comme l’élément constitutif de base. Marx avait largement développé le concept pour les sociétés occidentales[2]. Mais il n’avait fait qu’effleurer la question, et de façon discutable, pour les sociétés autres qu’occidentales, sous le nom générique de « mode de production asiatique » : rien sur l’Afrique, où Samir Amin développa le concept de « sociétés tributaires » et sur laquelle je me lançai hardiment à partir du fonctionnement des sociétés précoloniales africaines qui paraissaient si différentes de l’Occident[3].
C’est autour de ces premiers balbutiements théoriques discutés autour du Centre d’Études marxistes du Parti communiste, devenu un foyer de réflexion intellectuelle, qu’émergea au début des années 1960 la « théorie de la dépendance » développée par le germano-américain André Gunther Frank[4]. Elle fut élaborée en France par de jeunes chercheurs non pas comme une « théorie », mais comme un fait historique. L’économiste égyptien Samir Amin et le sociologue américain Immanuel Wallerstein développèrent l’idée de « centre » moteur et de « périphérie » dépendante, idée qui devait séduire Fernand Braudel et donc de jeunes historiens peu convaincus par les bienfaits de la modernisation comme seul moteur du développement prônée jusqu’alors[5].
Pour l’Afrique, ce mécanisme de dépendance aurait démarré à partir des « Grandes découvertes » hispano-portugaises des Amériques (fin du XVe-XVIe siècle), et de la mise en place de la traite atlantique des esclaves africains. C’était l’amorce de l’accumulation du capital occidental à partir de l’exploitation du reste du monde. La thèse fut renforcée par le géographe Yves Lacoste[6] pour qui le sous-développement des uns était provoqué par le développement de l’autre. Autrement dit, c’est parce que l’Europe occidentale a fait le saut la première que son expansion a empêché les autres de le faire. Son ouvrage fut traduit dans de très nombreuses langues et sa thèse fut renforcée par le concept d’« échange inégal » lancé par l’économiste Arghiri Emmanuel[7] : l’inégalité fondamentale était due à l’écart des salaires résultant d’un rapport de force défavorable entre les pays du Centre et ceux de la Périphérie, ce qui permettait au monde occidental d’exploiter outrageusement la force de travail des pays sous-développés. Les historiens exploitèrent ces idées pour analyser la dépendance coloniale.
Pour eux, il s’agissait moins de théorie que d’une démonstration à partir de l’observation des faits car l’histoire est une science plutôt expérimentale. Certes, l’ancrage originel de l’histoire africaine s’inscrivait alors dans l’horizon intellectuel marxiste et dépendantiste, mais à partir de l’interprétation des faits historiques que venait d’en proposer Fernand Braudel — qui ne relevait pas du marxisme — et qui prit l’allure d’une révolution méthodologique : renoncer à l’histoire linéaire dite « événementielle » qui avait prévalu jusqu’alors pour lui préférer l’analyse de l’interaction de faits historiques de natures différentes et de dimensions temporelles variables : brève (l’événement), médiane (la conjoncture à l’échelle d’une génération) et longue (la structure)[8].
À l’historien de démêler les mécanismes enclenchés par cette convergence des temps, chaque fois révélatrice de la complexité du processus. L’histoire devenait un travail à la fois d’observation et de réflexion, voire d’imagination contrôlée, magnifiquement développé par ce que l’on surnomma « l’École des Annales ». Les interprétations de l’historien sont des constructions élaborées qui n’étaient pas des théories. Mais les théories ambiantes suggéraient aux historiens en quête d’interdisciplinarité leurs pistes de recherche. Cela aboutit, entre autres, à un « panel » mémorable du congrès international de sociologie organisé à Varna en août 1969. Claude Meillassoux avait à peu près réuni tous les jeunes marxistes de l’époque intéressés par l’Afrique au sud du Sahara (Samir Amin, Immanuel Wallerstein, Anouar Abd el Malek, le couple Donal et Rita Cruise O’ Brien…) pour discuter, à partir d’une série d’études de cas précis, de l’ouverture ouest africaine au commerce international avant la colonisation, ce qui donna lieu à un ouvrage bilingue qui fit date[9].
Les subaltern studies
Ces réflexions sur la dépendance restaient liées à l’histoire conjuguée des métropoles et des colonies. D’où l’intérêt d’un courant novateur d’abord littéraire et bientôt de sciences sociales qui se développe hors de France dans les années 1970, celui des subaltern studies : l’exigence d’un regard des subalterns pour et par eux-mêmes. Le politologue Jean-François Bayart fut le premier en France à reconnaître l’importance de ce mouvement qui se développa en Inde avec entre autres la création d’une revue sous ce titre. L’ouvrage fondateur du Palestinien Edward Said, Orientalism, parut en 1978 et son succès entraîna sa traduction française rapide[10]. Mais elle fut alors quasiment ignorée, sauf par Jean-François Bayart qui en sentit tout de suite l’importance.
C’était l’air du temps, à peine perceptible en France. La convergence de pensée aboutit en 1980 à la revue politique africaine dont le premier numéro proclame la ligne éditoriale sous forme de programme : consacrer la revue à la « politique par le bas ». Le bruit fait par ce dossier contribua à faire redécouvrir en France Edward Said, dont la deuxième édition (2005) devint un bestseller. Or l’entreprise parallèle de l’historien philosophe congolais (RDC) Valentin Mudimbe, qui rédigea (en anglais) sur la construction occidentale de l’Afrique au sud du Sahara un travail similaire à celui de Said sur l’Orient, vient seulement d’être traduit en français, 33 ans après l’original, livre devenu un classique alors qu’il était à sa parution précurseur.
Cette œuvre essentielle résultait de la lecture attentive de la littérature occidentale sur l’Afrique subsaharienne. Peu l’ont lu, et l’on s’est contenté en France de citer abondamment le concept qu’il en tira, de « colonial library » (la bibliothèque coloniale) : Valentin Mudimbe a relu l’ensemble des Européens qui ont parlé d’Afrique depuis le XVIe siècle[11] : voyageurs, explorateurs, commerçants, marchands d’esclaves, missionnaires, administrateurs. Il a du même coup fait le procès de ce qu’il a appelé de façon imagée la colonial library dont nous avons tous été nourris, francophones et Français, par des décennies, voire des siècles de travaux certes utiles, mais tous frappés d’eurocentrisme. Comment se fait-il qu’Edward Said ait été traduit en français, mais que l’œuvre magistrale de Valentin Mudimbe, qui touche de bien plus près l’histoire française, ait tant tardé à l’être ?
Elle n’était connue en France que des quelques spécialistes qui ont eu le courage de se plonger dans ces ouvrages rédigés dans la langue d’adoption de leur auteur. Compte tenu de la vulnérabilité encore actuelle de l’opinion française sur la question coloniale (glorieuse épopée ou crime contre l’humanité ?), il ne s’agit sans doute pas d’un hasard. C’est aussi que l’histoire de France n’est pas, à proprement parler, « décolonisée » pour le public, ce qui peut rendre les éditeurs frileux. Elle ne l’était pas non plus, ne serait-ce qu’inconsciemment, pour certains historiens[12].
Hostilité et réticences
L’hostilité ou la réticence des chercheurs en sciences sociales sur les pays du sud contre les « idées postcoloniales » peut s’expliquer en partie parce qu’elles incitent à remettre en cause les convictions, conscientes ou inconscientes, héritées de notre commune « bibliothèque coloniale ». Au contraire, le mouvement étatsunien postcolonial qui découla très vite des subaltern studies réclama vigoureusement une histoire vue du point de vue des colonisés, y compris dans leurs rapports avec les colonisateurs, comme l’avaient fait en France dès l’après-guerre quelques rares intellectuels rebelles : Albert Memmi a expliqué à quel point le colonisé et le colonisateur formaient un binôme inséparable en incessante co-résonance[13], Frantz Fanon aujourd’hui presque oublié, même si on commence à le redécouvrir, fut essentiel[14], sans même parler de la violence salutaire du discours sur le colonialisme d’Aimé Césaire en 1950[15].
L’idée n’était donc pas nouvelle. Les promoteurs en avaient été, dès les années 1945, des penseurs du « tiers-monde » comme on disait en ce temps-là. Ces écrits avaient fait à l’époque grand bruit, mais en France seulement chez une minorité d’intellectuels et de militants. Cette fois, revivifiés par les postcolonial studies, ils furent mieux entendus. Dans cette mesure, Jean-François Bayart ou Jean-Loup Amselle ont eu raison de souligner que des penseurs français ou francophones d’envergure avaient déjà beaucoup donné, pour dire à peu près les mêmes choses dans un langage différent.
Ces happy fews estimèrent donc à l’époque que, puisqu’ils avaient été dans leur jeune temps capables de l’entendre, ils n’avaient pas à y revenir. Certes, les postcolonial studies ont donné lieu, comme il est habituel lorsqu’émerge un nouveau concept, à une multitude d’analyses postérieures secondaires et confuses, souvent rejetées à l’époque, car taxées d’anti-marxisme, qui n’ont pas apporté à la pensée critique d’éléments majeurs, à l’exception d’un seul, sur lequel je vais revenir dans un instant, et qui est essentiel dans le cas français. Cela explique, du même coup, pourquoi les postcolonial studies ont eu tant de mal à s’implanter en France, en particulier pour les études africaines. Car il y a eu de grands précurseurs, mais qui se sont plutôt intéressés aux sociétés d’Amérique latine : à l’époque, l’attention aux autres et la confrontation aux sources autochtones a été introduite par Nathan Wachtel sur les Incas, et plus récemment par Serge Gruzinski[16].
Seconde partie à suivre dans une prochaine lettre du Groupe de recherche Achac.
1 Jean Stenger, Combien le Congo a-t-il coûté à la Belgique ?, Bruxelles, Académie Royale des Sciences, 1956.
2 Marx analysait le mode de production par l’interconnexion de deux facteurs : les forces productives et les rapports sociaux de production. Staline l’avait dénaturé en imposant une succession linéaire universelle en 5 stades : la horde, l’esclavage antique, le féodalisme, le capitalisme, avant d’accéder au stade suprême du communisme.
3 Centre d’Études et de Recherches Marxistes (dir.), Sur le mode de production asiatique, Éditions sociales, 1969. Dans la seconde édition (1973) y était joint un article publié en 1969, « Recherches sur un "mode de production" africain ? », La Pensée, n°144, pp. 3-20. Cet article plusieurs fois traduit eut chez les anglophones un écho dont je fus la première à m’étonner.
4 André Gunder Frank, Capitalisme et sous-développement en Amérique Latine, Paris, Maspero, 1968 ; Le développement du sous-développement : Amérique latine, ibid., 1970. Il élabora sa théorie au Chili (1962-1973).
5 Jacques Ellul, La technique ou l'enjeu du siècle (1952), rééd. Economica, 2008.
6 Yves Lacoste, Géographie du sous-développement, Paris, PUF, 1965.
7 Arghiri Emmanuel, L’échange inégal, Essai sur les antagonismes dans les rapports économiques mondiaux, Paris, Maspero, 1969.
8 Fernand Braudel, « Histoire et Sciences sociales : La longue durée », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, vol. 13, 1958.
9 Claude Meillassoux, L’Évolution du commerce africain depuis le XIXe siècle en Afrique de l’Ouest (édition bilingue), Oxford, Oxford University Press, 1971.
10 Traduit L'Orientalisme : l'Orient créé par l'Occident, Paris, Le Seuil, 1980 [2005].
11 Valentin Mudimbe, The Invention of Africa. Gnosis, Philosophy, and the Order of Knowledge, Bloomington, Indiana University Press, 1988 ; traduit : L’invention de l’Afrique. Gnose, philosophie et ordre de la connaissance, Paris, Présence africaine, 2021 [1994].
12 Le florilège d’ouvrages grand public d’historiens sur la question en 2006-2008 : Pour en finir avec la repentance coloniale, Daniel Lefeuvre (Flammarion, 2006) ; Nous ne sommes pas coupables, Paul-François Paoli (Editions Table ronde, 2006) ; La tyrannie de la pénitence. Essai sur le masochisme occidental, Pascal Bruckner (Grasset, 2006) ; Fier d’être Français, Max Gallo (Fayard, 2006) ; Quand l’État se mêle de l’histoire, René Rémond (Stock, 2006) ; L’Histoire assassinée : les pièges de la mémoire, Jacques Heers (Editions de Paris, 2006) ; L’âme de la France. Une histoire de la nation, Max Gallo (Fayard, 2007) ; Qu’est-ce que la France, sous la direction d’Alain Finkielkraut (Stock, 2007) ; Faut-il avoir honte de l'identité nationale ? Daniel Lefeuvre & Michel Renard (Larousse, 2008) ; La France sans identité. Pourquoi la république ne s’aime plus ? Paul-François Paoli (Editions Autres Temps, 2008).
13 Albert Memmi, Portrait du colonisé, précédé du portrait du colonisateur (préface Jean-Paul Sartre), Paris, Buchet/Chastel, 1957.
14 Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, 1952, rééd. Le Seuil, col. « Points », 2001, et Les Damnés de la terre, Paris, Maspero, 1961. Symbole de la lutte anticoloniale par son engagement dans la guerre d’Algérie aux côtés du FLN, il a marqué de son empreinte les luttes qui ont conduit à la fin des empires coloniaux. Médecin psychiatre né aux Antilles françaises dans l’entre-deux guerres, il a éclairé ces luttes par ses livres. Cf. Marie-Jeanne Manuellan, Sous la dictée de Fanon, L'Amourier Éditions, 2017.
15 Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, Paris, Présence africaine, 1955.
16 Nathan Wachtel, La Vision des vaincus, Les Indiens du Pérou devant la conquête espagnole (1530-1570), Paris Gallimard, 1971 et Serge Gruzinski, Quelle heure est-il là-bas ? Amérique et Islam à l’orée des temps modernes, Paris, Seuil, 2008.
